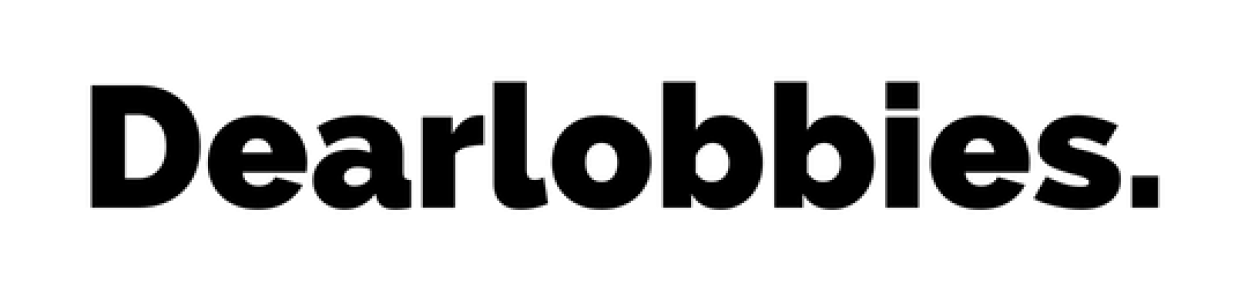Extraits
Source : Déclaration de Stockholm. Nations Unies, 1972
Nous sommes à un moment de l’histoire où nous devons orienter nos actions dans le monde entier en songeant davantage à leurs répercussions sur l’environnement. Nous pouvons, par ignorance ou par négligence, causer des dommages considérables et irréversibles à l’environnement terrestre dont dépendent notre vie et notre bien-être.
Article 6